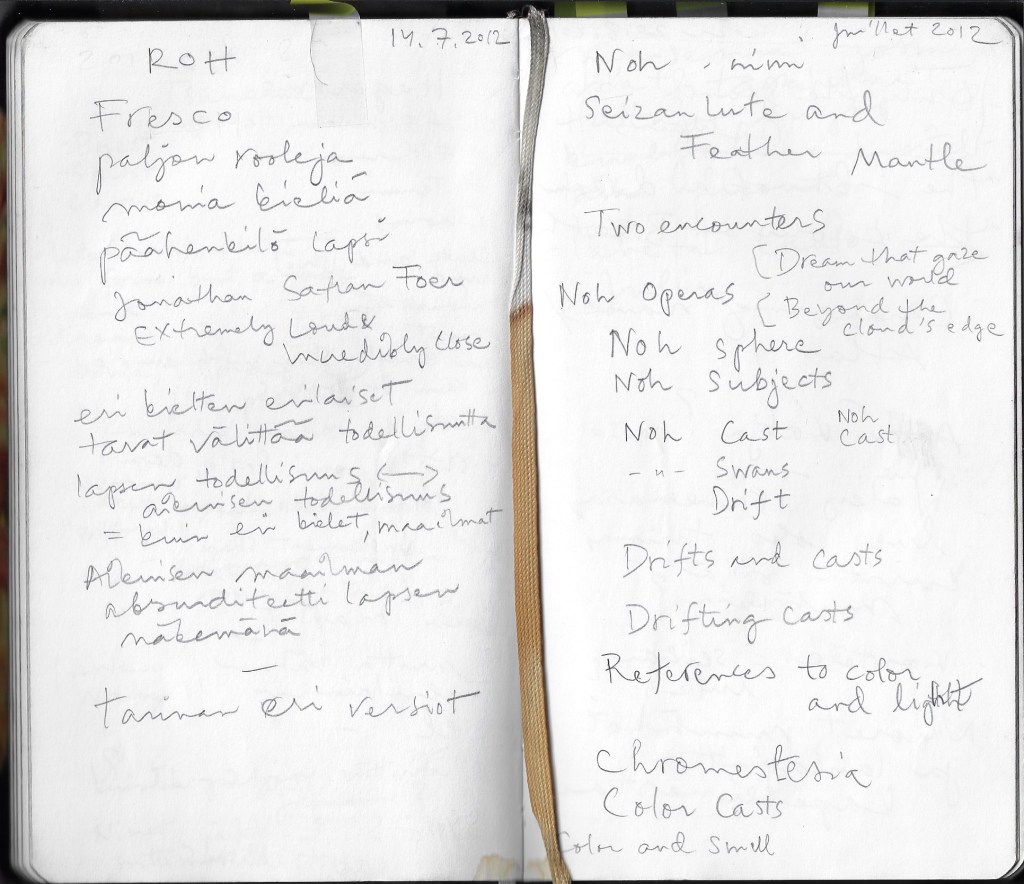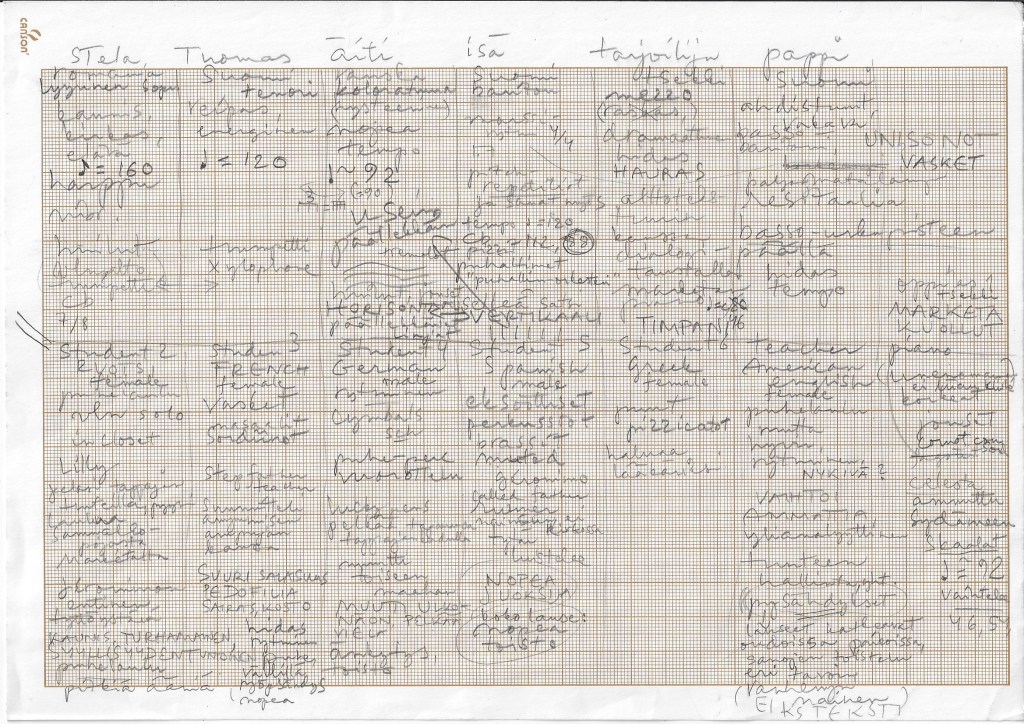Le sous-titre de ce texte suggère qu’il est, un an plus tard, la suite de celui qui s’intitulait ÉPIDÉMOCRATIE, mais nous avertit aussi qu’il est deux fois plus long. Espérons pour d’éventuelles suites une croissance non-exponentielle.
Isolé·e·s les un·e·s des autres et, selon les cas, écrasé·e·s par l’incertitude de l’avenir ou submergé·e·s par les demandes de flexibilité accrue, étouffé·e·s par la peur ou par la colère, désemparé·e·s et/ou révolté·e·s, nous sommes, et c’est impossible autant que nécessaire, mis·e·s en demeure de penser. Impossible, car le virus domine le discours, et on ne peut pas penser pour ou contre le virus : nous nous perdons quand nous cherchons à faire l’un ou l’autre. Nécessaire pourtant, parce que ce que le virus fait saillir, dans la manière dont les pouvoirs publics y réagissent et dans la manière dont nous réagissons à cette réaction, les conditions réelles de notre vie matérielle, et les systèmes de sa laideur. Nous avons à apprendre des violences sociales et individuelles qui se font jour. Ne nous laissons pas enfermer dans les symptômes, en croyant par exemple combattre la dictature par le refus des masques, ce qui est aussi illusoire que de croire combattre le terrorisme par le refus de l’immigration. Essayons plutôt de comprendre pourquoi nous sommes de si mauvais sujets de pandémie, et une si piètre terre d’accueil. Pour mieux diriger nos indignations, voire nos révoltes, et pour construire une meilleure maison commune.
LA RÉPUBLIQUE DU COUVRE-FEU. Le couvre-feu conçu comme un reconfinement du loisir est un choix idéologique tellement tranché qu’il prête nécessairement à penser, en tant qu’il place anthropologiquement au centre de la vie humaine l’activité économique sous la forme du salariat et de l’(auto-)entreprenariat. La manière dont ce couvre-feu a été mis en mots par le Président de la République au moment de le décréter dans son interview du 14 octobre 2020 a valeur de programme, même s’il ne faut pas prendre pour « argent comptant » (dans une économie du discours entièrement fondée sur le « crédit ») la propre capacité du Président à le théoriser de manière adéquate. Les déclarations de quelqu’un comme Emmanuel Macron ne peuvent pas se lire comme la formulation d’une théorie politique : elles sont un témoignage d’archive sur une idéologie.
Si la pandémie semble inciter à une économie orientée vers l’emploi flexible et la consommation uberisée, et fait depuis un an très concrètement la fortune des entreprises dont c’est le modèle économique et managérial, c’est que celles-ci représentent le monde même qui permet la pandémie, auquel la pandémie est consubstantielle, et que nous appelons ÉPIDÉMOCRATIE. Ce régime où le politique est asservi à l’économique au point d’y réduire son extension met constamment à l’épreuve notre tolérance, tout en réduisant les espaces dans lesquels on peut y proposer des alternatives, fondées sur la proximité, la lenteur et les élections qui ne relèvent pas des logiques de la brigue et des rapports de force claniques, organisés en rapports de classes sciemment rendus illisibles.
En annonçant le couvre-feu et en décrivant ce qu’il allait être, le Président a prononcé quelque chose comme un discours de campagne cauchemardesque, tout entier contenu dans une formule qui reflète son goût pour les synthèses téméraires, en l’occurrence entre le travail et la sociabilité : « On se socialisera, mais au travail ». Terrible en-même-temps.
Le choix du mot dans la bouche du Président évoque tout un champ lexical de son rapport au travail. Ainsi la décision en 2019 (remake d’une mesure sarkozyste) de « désocialiser » les heures supplémentaires, c’est-à-dire de les rendre plus attractives superficiellement en les exonérant de cotisations sociales au profit du net perçu, donc du « pouvoir d’achat » individuel. On pense aussi aux Ordonnances Macron de 2017 qui faisaient primer (dans la continuité de la Loi El Khomry de 2016) les accords d’entreprise sur les accords de branche, c’est-à-dire mettaient en demeure les salariés de négocier avec leurs employeurs sans pouvoir s’appuyer sur la force du nombre des syndicats de branche et des confédérations.
On le voit, le projet – largement antérieur à l’épidémie – est de faire vivre comme une émancipation la réduction à une solitude du rapport du salarié à son emploi. Dans cette démarche, entretenir une culture de l’individualisme, au détriment des solidarités, est une nécessité. Est alors pleinement réalisée l’idée selon laquelle ce sont les rapports de production matériels qui sont le lieu de la production sociale de notre existence, dans un cas d’école dont la limpidité fait honneur au « conseil aux jeunes » prodigué dans Elle Magazine par le Président au moment de son élection : « lire Karl Marx ».
La règle des « six personnes maximum », arbitraire, ne s’applique pas aux lieux de travail. C’est donc bien que c’est dans le travail seulement que les individus sont invités à s’agréger en société. Pour décrire l’horizon d’une superposition parfaite de la société et du travail, ou si l’on veut de la société civile et de la société anonyme, on pourra se permettre sans soupçon d’emphase le mot de dystopie. A contrario, la convivialité choisie – festive mais pas seulement – est désignée comme relevant de l’univers de la contagion. Les réels carrefours de la contagion sont pourtant connus : ce sont les lieux de travail et d’études, les moyens de transport et les foyers familiaux, qui forment un système clos de routine et de traçabilité donné comme plus petit commun dénominateur de la société et de la vie humaine, en dehors duquel n’existe que du « non-essentiel », et du non-régulable. Le fait que les moyens efficients de sécurisation des espaces autorisés (à commencer par leur désaturation) ne soient pas mis en œuvre, tandis qu’ils existent pour un certain nombre de lieux de sociabilité non-autorisés, reflète non une mesure pragmatique, mais une cartographie idéologique qui est un projet anthropologique. Celui de l’abolition du « monde commun », de ce « domaine public » dont Hannah Arendt dit qu’il « nous rassemble mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les autres ». L’augmentation depuis un an des violences domestiques et des formes de mal-être psychique en est un rappel douloureux.
Nous devons cependant nous méfier du parallèle qui nous vient facilement avec les régimes autoritaires que nous connaissons et, autre pensée-réflexe, avec les dystopies singulières décrites par exemple dans 1984 de George Orwell et Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Cette méfiance n’est pas à ancrer dans le refus des enseignements que nous pouvons tirer des précédents historiques et de la littérature d’anticipation, qui sont dans un cas comme dans l’autre immenses et précieux. Mais ces rapprochements nous mettent au risque de mal comprendre les spécificités des régimes actuels. Il s’agira, dans un usage raisonné de la comparaison, d’éviter les deux écueils de la reductio ad Hitlerum systématique autant que du « mais ce n’est pas comparable », cette pose si confortable qui dispense tout un chacun de critique politique, ou ne serait-ce que d’un examen de conscience, tant que la population ne disparaît pas par convois entiers. Il s’agira, donc, d’un certain usage de l’histoire et de la littérature : laisser celles-ci nous aiguillonner et nous aiguiller, sans y chercher des réponses qui ne sont propres qu’à nourrir notre confusion. La méfiance, que leur étude enseigne au contraire de l’idéologie, est un outil précieux face à un réel qui ne cesse de se dérober, et pour lequel nous serons toujours mal préparés. C’est pourquoi il importe de porter notre réflexion par la langue et sur le langage, pour faire les distinctions qui permettent la critique sans confusion. Les dictatures autoritaires et les régimes totalitaires existent. Les mouvements fascistes existent. Le mode de production capitaliste existe, et ses acteurs et ses idéologues nous travaillent au corps. Le mot de capitalisme est, pour sa part, un outil critique peu fiable, puisque l’on désigne par là des idéologies économiques différentes, et que ce n’est pas un mode d’organisation politique. C’est pourquoi je parle ici de l’ÉPIDÉMOCRATIE, qui est un régime politique. Absolument libéral et résolument populiste, dans le mouvement même où il est arbitraire et élitaire. C’est pourquoi nous ne pouvons pas en chercher dans le 20e siècle et ses cauchemars des exemples, mais que nous devons y étudier sa préhistoire.
ARCHIVE DU MONDE ATOMISÉ. L’erreur originelle de la plupart des théories complotistes – qu’elles partagent d’ailleurs avec les vues transhumanistes les plus grotesques des classes dominantes – est de prêter aux élites une intelligence supérieure. Il est pourtant essentiel de percevoir dans l’ÉPIDÉMOCRATIE une machine à produire de la bêtise qui n’exclut pas ses propres élites. L’assignation de rôles entre les intelligents et les stupides, entre les rationnels et les émotifs, est en réalité aussi abrutissante pour toutes les parties : le complexe de supériorité est aussi prompt que le complexe d’infériorité à obscurcir le jugement critique. Les élites qui s’écoutent parler, qui étalent une culture superficielle, qui se réjouissent d’inventer l’eau tiède en jouant toujours avec les deux mêmes valves, qui brandissent comme des idées neuves de vieilles idéologies encroûtées sont certes manipulatrices, mais elles sont surtout incapables de dissimuler le vide de leur propre pensée, leur incapacité à conceptualiser la complexité et le long-terme. Il est plus aisé de se rêver en chef de guerre providentiel qu’en architectes, de promettre la « réussite » que l’égalité et l’émancipation, la « sécurité » que la paix, « l’orientation scolaire » que l’instruction, la réanimation que la santé publique dans toute sa multifactorialité. À quoi bon pour les élites un monde où l’on ne s’illustre pas, en public ou dans ses propres cercles ? L’état du système éducatif public prête à confusion chez les commentateurs : certes on peut relever qu’un auditoire moins éduqué est plus facile à berner, mais plutôt que de penser que nous avons affaire à une opération mondiale de déséducation, il nous faut reconnaître à quel point l’ignorance, la superstition, le manque de cette culture à la fois éclectique et spécialisée qui caractérise l’humanisme gangrène les élites elles-mêmes. Ou pour reprendre un constat courant de l’après-2008 : les élites financières ont été confirmées dans leur sentiment d’impunité par leur sauvetage par de l’argent public aussitôt réinjecté en investissements – aménagés par des politiques fiscales qui confirment la continuité des circuits étatiques et financiers et la politicité de ceux-ci. Cependant, les combines qui ont permis l’accumulation de produits financiers toxiques par le jeu avec la légalité ne trahit pas une intelligence supérieure en tant qu’elle serait planificatrice et capable de voir au-delà d’elle-même. Au contraire, c’est l’adoubement de la pensée court-termiste, recroquevillée – jusque dans son traitement de chaque crise sociétale structurelle et de la crise existentielle la plus massive de notre histoire, la crise écologique – sur des calculs qui ne reposent que sur des stratégies mesquines et un sentiment d’immortalité dans et par la catastrophe : c’est la marque de l’ÉPIDÉMOCRATIE, régime de la bêtise.
Cette prudence dans la lecture des événements doit s’appliquer aussi aux intentionnalités qui s’exercent depuis le début de la pandémie. Les mesures sanitaires n’affichent pas sur leur front de couleur politique – pas plus d’ailleurs que juridiquement parlant les mesures d’urgence, dont relevaient par exemple de manière simultanée en 1933 le New Deal de Franklin Roosevelt et les décrets liberticides d’Adolf Hitler. En 2020, à chaque étape de l’épidémie et à niveau de contagion égal, les mesures des différents gouvernements et autorités locales se sont beaucoup ressemblé, parce qu’elles reflétaient un état des connaissances scientifiques, faillible mais objectivable. Décrétée même par la Suède, l’interdiction des rassemblements n’a pas nécessairement un arrière-goût de dictature. On doit certes regretter le choix de l’interdiction légale plutôt que de la recommandation confiante, et le discours sous-jacent qu’il suppose sur la nécessité d’encadrer la population pour la protéger – ce paternalisme-là est un fondement civilisationnel du droit tellement profondément ancré qu’il ne disparaîtrait que par des évolutions culturelles radicales de nos conceptions de l’État. En revanche, un critère plus saillant est la manière dont le pouvoir politique accompagne ces mesures : à quel point la protection qu’il prodigue est égalitaire dans le réel des fractures sociales et géographiques, par exemple. « Confiner » est en soi moins déterminant que de savoir comment le confinement est aménagé de manière à ce que le risque sanitaire et économique soit également bas partout dans la société. En France, les conditions de confinement voire les impossibilités matérielles de se confiner (au sens d’adapter son activité professionnelle ou même d’avoir un lieu pour le faire) ont révélé d’une façon particulièrement aiguë les inégalités sociales et les ont amplifiées, mettant l’État face non seulement à son incapacité à les compenser dans l’urgence, mais aussi à la négligence (ou au cynisme) du pouvoir politique « républicain » sur le long terme. Ici l’abandon progressif des services publics de la santé et de l’éducation n’est malheureusement qu’un symptôme de la situation générale. De surcroît, la centralisation du pouvoir a montré ses défaillances intrinsèques, tant les collectivités locales ont appliqué des mesures prises en haut en laissant le concret du quotidien aux initiatives individuelles et aux entreprises privées (en ce qui concerne l’alimentation notamment). Dans des territoires structurés sur le long-terme selon des habitudes d’autogestion, des pratiques ne serait-ce que de circulation, d’activités en extérieur et de garderie auraient pu se mettre rapidement en place qui auraient tempéré de beaucoup le choc. C’est aussi la dissolution bien avant le début de l’épidémie de notre « monde commun », notre incapacité à articuler la vie locale, qui conduit à des mesures drastiques qui ne souffrent pas d’exceptions – puisque l’état d’exception est généralisé.
Depuis plusieurs hivers, les services d’urgence des hôpitaux français sont, selon la formule désormais consacrée, « submergés » au moment des épidémies de grippe. Avec la cyclicité qui est celle des épidémies saisonnières, le problème a été chaque année mis en avant, et corrélé à la politique de fermeture de lits et de suppressions de postes. Étaient connus non seulement la crise structurelle (dans les périodes épidémiques, et en général du fait du vieillissement de la population et de la recrudescence des maladies chroniques liées à notre mode de vie, à notre alimentation, à notre environnement) mais aussi la probabilité de la multiplication des épidémies graves. L’inadéquation entre le système de santé que l’on construit et les problématiques sanitaires de notre société pose nécessairement question. Au sens fort : pour l’esprit rationnel, il semble incompréhensible que les mesures de santé publique soient en contradiction avec les tendances lourdes des enjeux sanitaires, et ce de manière répétée, réaffirmée au fil des ans, par des gouvernements différents. Il faut bien se résoudre à une vérité plus dérangeante que tous les complots : nous vivons dans un monde qui, tandis qu’il prétend rationnaliser les ressources, est d’autant moins guidé par la raison. C’est le propre de la logique gestionnaire. Au sein d’une structure hiérarchique, chacun applique un cahier des charges se voulant rationnel, souscrivant à des idéaux d’optimisation et de performance, mais la conduite de l’ensemble n’a aucun sens, et la responsabilité en est entièrement diluée. On peut laisser ce modèle proliférer jusqu’à ce que son entropie laisse entrevoir comme seule solution la mise en place d’une volonté verticale forte de réformer le système, qui se heurtera inévitablement au fait que la pyramide gestionnaire est en fait impossible à réformer, appelant plus de verticalité encore. Comment la bureaucratie produit de l’autoritarisme, qui en retour s’appuie sur la bureaucratie, c’est un point analysé lui aussi par Hannah Arendt et sur lequel nous n’avons pas besoin de revenir. Mais cet exemple parmi tant d’autres montre que le régime gestionnaire a pour seule alternative viable celui de la démocratie : elle seule court-circuite les structures pyramidales en introduisant la nécessité de concertation qui permet d’interroger de manière continue la rationalité des prises de décision, non au sens de la « rationalisation » productiviste taylorienne mais de ce qui fait sens. La démocratie est le régime de la raison vécue et agissante (qui s’oppose ici à la rationalisation, comme le sens s’oppose à la direction), et c’est tout le travail de sape qui veut nous convaincre du contraire qui nous met en danger. Ce travail de sape se fait dans deux mouvements complémentaires : d’une part privatiser la rationalité, en faire l’apanage d’une élite ; d’autre part superposer à la démocratie en devenir un régime effectif de l’émotion qui la discrédite, et que nous appelons ÉPIDÉMOCRATIE.
Simplifier le code du travail ou faire entrer l’état d’urgence dans la loi relèvent de la même logique : désentraver tout ce qui est compliqué par les institutions propres à l’état de droit. La gestion de crise est la forme de gouvernance qui accorde le plus de liberté aux gouvernants. Se régler sur l’épidémie c’est prendre pour modèle la perpétuelle mutation, l’injonction à la flexibilité toujours justifiée par un indiscutable « pragmatisme », en assumant de faire vite et mal comme un virus, plutôt que discuter, raturer et corriger. On comprend comment la séduction d’un devenir-virus a pu entraîner tant de libertaires vers un libéralisme débridé, vécu comme pure synthèse qui se dispense des difficultés de la dialectique, à l’aide de drogues de synthèse elles aussi.
IDIOTS, ÉMOTIFS, MALADES, RÉSILIENTS. On parle beaucoup d’une « hystérisation » et d’une « polarisation » du débat public. Ainsi mal nommée, l’agressivité effectivement croissante de la parole pourrait sembler un mouvement étonnant dans une société où le discours « républicain » est dominé par l’idée de « réconciliation », l’ombre portée de Habermas, le « dépassement des clivages ». Cette prétendue réconciliation est certes souvent un jeu de dupes, et n’est pas autre chose que l’argument capitaliste ancien : mettre fin à la lutte des classes en croyant à un intérêt commun que serait la productivité, qui ne saurait déboucher que sur la prospérité universelle, en somme sur une grande collaboration réussie. La mobilisation de l’idée d’hystérie s’avère cohérente avec l’usage paternaliste qui est fait de ce mot dans un sens littéral. Ici comme dans les rapports hommes/femmes, cet usage repose sur un biais de confirmation : plus une femme est poussée dans ses retranchements par le refus de son milieu de prendre en compte ses revendications, plus elle pourra être qualifiée d’hystérique. Cette accusation est censée affirmer en creux la sagesse et la placidité de celui qui la profère, et ainsi perpétuer une distribution des rôles. C’est sous cet angle qu’il faut lire les déclarations d’un certain nombre de membres du gouvernement français sur « l’hystérisation du débat public » : non en niant la polarisation de la parole, mais en percevant bien le rôle qu’y joue l’accusation d’hystérisation elle-même – à savoir s’extraire du conflit (donc du débat) en faisant mine de parler depuis une hauteur de vue supérieure. Nourrissant ainsi l’escalade du ressentiment, et ce plutôt que d’entrer dans un mécanisme démocratique, qui suppose l’égalité de stature intellectuelle des voix en présence. Une supposition en droit et par principe, sans assignation et sans dopage.
L’ÉPIDÉMOCRATIE consiste, nous l’avons dit, à maintenir constamment la sphère du politique dans le régime des émotions. Or la revendication d’une position extérieure à ce régime, position faite de rationalité et d’intention planificatrice, n’est pas contradictoire avec le maintien de celui-ci, au contraire elle en est un outil précieux. Par un double mécanisme : d’abord parce que la confiscation répétée de la rationalité (par l’homme « compétent » dénoncé par Jacques Rancière) induit nécessairement un repli de l’autre sur le régime émotionnel ; ensuite parce que le régime verbal de l’insulte est de nature à entretenir un mode de réaction émotionnel plutôt que rationnel. Répondre systématiquement à l’insulte par l’argumentation calme, on s’en rend compte à toutes les échelles de la communication humaine, relève de la sainteté – que, n’étant ni catholique ni économiste, nous ne saurions ériger en paradigme par défaut. Le cortisol ne se déconstruit pas davantage qu’une inondation.
Un effet structurel de ce mécanisme est de transformer la majeure partie des vecteurs de contestation en idiots utiles d’un régime, ou pour mieux dire le climat généralisé de polarisation exacerbée fonctionne comme un régime d’idiotie utile. La tentative de donner à l’État le monopole de la rationalité entraîne des tentatives de réappropriation sous la forme de thèses et de réseaux d’information complotistes, dont les éléments de vérité éventuels sont noyés dans les scories disqualifiantes. Ainsi naissent aussi les fanatismes : de l’investissement émotionnel de revendications politiques qui ne trouvent pas dans l’ordonnancement de la sphère publique d’espace d’expression. L’expression de la haine, y compris dans son escalade en actes criminels ou monstrueux, permet précisément ce à quoi servent les monstres : se concentrer sur les symptômes plutôt que sur les causes. L’ÉPIDÉMOCRATIE fait un monde dans lequel les symptômes sont substitués aux signes. Dans ce monde, sont suscitées des forces réactives qui sont réactionnaires, désespérément rabougries sur des logiques identitaires, et jusque dans leur rhétorique de promesse d’émancipation par le retour à soi, conservatrices. Cela au bénéfice d’un marché de la polarisation lui-même lucratif, dans lequel les plateformes des réseaux sociaux analysent les biais idéologiques et concentrent les contenus offerts aux utilisateurs sur ceux qui abondent dans la direction de leurs opinions avérées ou probables, afin de maximiser le nombre de clics – l’effet de bord en est nécessairement le renforcement des déterminismes, la radicalisation des opinions déjà formées et le désapprentissage de la confrontation à des opinions différentes, pour ne pas parler de l’accès ne serait-ce qu’aux éléments factuels de la contradiction. Le marché dérégulé de l’information est lui-même une machine à bêtise, une bêtise dont le fanatisme est la forme la plus spectaculaire mais non nécessairement la plus répandue, la plus violente ou la plus dangereuse.
Au demeurant il n’y a rien de nouveau dans le partage des rôles qui consiste à considérer la rationalité comme relevant de l’élite, et la foule comme relevant de l’émotion. C’est la base même de la rhétorique antidémocratique, qui a l’âge de l’idée de démocratie. Mais l’originalité de l’ÉPIDÉMOCRATIE est de réussir le tour de force consistant à associer des institutions démocratiques à un postulat antidémocratique. Le mystère réside dans l’articulation de l’individuel et du collectif. C’est là que se joue la différence entre individu et sujet, et entre masse et multitude. Le récit de la foule livrée à ses émotions consiste à considérer que les individus constituent la masse, et que par rétroactivité l’appartenance de l’individu à la masse le rend inapte à la rationalité. Le paradoxe selon lequel la disqualification de la masse comme entité politique décisionnaire passe par la promotion de l’individu n’est qu’apparent et donc superficiellement seulement paradoxe. C’est en tant qu’elle n’est pas sujet pensant mais individu que la personne humaine est vouée à être unité constitutive de la masse, atome livré à ses turbulences, en même temps que lui est accordée la liberté dite « individuelle » qui la rend seule responsable de son sort. La masse est un nuage de points, et se gouverne comme tel. La multitude, quant à elle, serait l’ensemble des sujets pensants, un ensemble qui ne fait pas corps de manière homogène, mais qui est traversé par toutes sortes de mouvements, de structures, de circuits et de réseaux. C’est dans la multitude et non dans la masse que peut se produire la subjectivation qui nous fait sujets d’une démocratie (au sens cette fois grammatical, épicène et non servile du mot sujet), en même temps que la collectivisation dont émerge du collectif.
Sujets et non sujet·te·s. Non en tant que dotés d’un illusoire libre-arbitre, mais en tant que consciences qui partent à la découverte de leurs propres déterminismes pour naître au monde à nouveaux frais. Sujets capables aussi de mieux que l’injonction – désormais intégrée au lexique gouvernemental au même titre que celle à l’effort et à la rigueur – à la résilience, dans un détournement acrobatique du vocabulaire de la psychologie consistant à simultanément embourber la masse et chaque individu dans le statut d’un choc post-traumatique permanent, et à les rendre responsables de leur propre convalescence, dont les ressources ne seraient à trouver qu’en eux-mêmes. Le paradigme de la croissance post-traumatique, comme tant d’autres concepts arrachés par les communicants à la complexité de leur champ d’origine dans cette récupération dont le « développement personnel » est exemplaire, devient un énième mécanisme de culpabilisation et de refus de la contestation. C’est le dernier avatar en date de l’invitation vigoureuse à « se prendre en main », de l’éternel argument selon lequel il convient de cesser de rejeter la faute sur les autres, comme si l’on pouvait, encore une fois, défendre ainsi les responsables politiques contre le besoin de leur demander des comptes, de leur réclamer d’endosser pour leur part la responsabilité qui leur a été collectivement confiée, et dont le débat démocratique est censé être la constante assurance, mutualisée et non privatisée. En ÉPIDÉMOCRATIE, ce débat passe pour une jérémiade puérile.
ÉMANCIPATIONS. Dans la mesure où, comme l’écrivait quelqu’un qui a peut-être trop cru dans la fin programmée des empires, « ce n’est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience », il est inutile d’espérer l’effondrement du régime de l’ÉPIDÉMOCRATIE par la simple magie d’une prise de conscience individuelle et collective. L’individu éclairé est à l’individualisme ce que le despote éclairé est au despotisme, ou ce que le capitalisme vert est au capitalisme : la perpétuation d’une structure mortifère par des atours cosmétiquement préférables. Il n’y a, du reste, pas d’effondrement possible de l’ÉPIDÉMOCRATIE, puisque l’ÉPIDÉMOCRATIE est un état de perpétuel effondrement qui se nourrit de sa propre déliquescence, et de la confusion que celle-ci permet. Il ne s’agit pas de lui opposer la conservation ou la continuité, mais la complexité et le procès.
Ce n’est qu’en changeant les conditions matérielles de la vie que se produira la subjectivation par laquelle les individus s’émanciperont de leur condition d’individus. Leur condition, donc, de patients, toujours en thérapie, et toujours appelés à être patients au sens premier, dans l’attente de la fin des efforts à consentir tant que durera une crise qui n’est pas vouée à se terminer.
L’idéologie d’inspiration kantienne selon laquelle il s’agit pour l’homme de « sortir d’un état de minorité dont il est lui-même responsable » repose sur une supposée capacité individuelle à s’émanciper permise par la liberté d’opinion et le courage de penser. La formulation de Kant tend à faire oublier qu’il concède lui-même que la paresse et la lâcheté sont des sentiments dans lesquels la masse est sciemment maintenue, et que sa foi dans les Lumières ne tient pas qu’au surgissement au sein de la masse d’esprits exceptionnels spontanément dotés d’un courage remarquable. Sa solution idéale est justement celle du despote éclairé, supposant un mariage fantasmatique entre l’obéissance des individus qui assure l’ordre social et la liberté d’expression de ces mêmes individus, permettant à chacun d’exercer publiquement une contribution critique constructive à l’intérêt général sans être inquiété pour cela. Mais cette société-là est imaginaire, elle repose sur un contrat social qui n’est pas reconduit dans les faits mais censé émerger de la conduite de la raison supposée universelle. Or la « volonté universelle » n’a pas besoin pour Kant d’être exprimée par chacun, suffisent des dirigeants qui en soient les interprètes experts. L’abus de cette position universaliste, nous avons vécu assez longtemps pour le voir en actes : c’est l’accaparement par les élites de la légitimité à la pensée rationnelle, au nom de la représentation et de la délégation. Celles-ci sont les noms de la curatelle qui remplace aujourd’hui le statut de la « minorité » de l’humanité. Volonté universelle, volonté générale, ce sont des fictions qui dispensent d’expression la volonté de chacune et de chacun dans la redoutable, l’éternelle députation consentie au n+1.
C’est la subjectivation émancipatrice qui nous place en position d’exercer notre rationalité plutôt que de nous vouer à l’émotion réactive, comme le font la mauvaise télévision et le mauvais théâtre. Ce n’est pas le lieu de rappeler ici que l’art peut tout le contraire, en offrant au spectateur, en tant que sujet politique et en tant que sujet émotionnel, un espace sans coordonnées fixes dédié à une subjectivation émancipée, et qu’il relève lui aussi de la santé publique : car ce n’est pas le moment de réfléchir à l’art qu’on est dans l’impossibilité de faire. Réservons la traduction.
L’émancipation de nos émotions réclame une sphère politique qui renonce à fonctionner à l’émotion, que celle-ci soit connotée positivement ou négativement. Nous n’avons la liberté de vivre nos émotions que si elles ne sont pas objets de politique et instruments de politique. Nous ne pouvons nous livrer à la jouissance et au délire que dans un monde où notre parole singulière est par ailleurs entendue comme celle d’un sujet politique admis comme rationnel, donc comme compétent.
Dans la multiplication des moments pré-insurrectionnels qui partout dans le monde ont précédé le couperet épidémique, nous pouvions saluer le mouvement général de subjectivations par lequel, en groupe, celles et ceux qui n’étaient que des individus s’inventaient de nouvelles assignations ; par lequel ils et elles descendaient dans la rue, c’est-à-dire contemplaient ensemble le réel à hauteur humaine. Mais il nous faut aussi affirmer que le sujet n’est guère qu’un « stade du miroir », et les subjectivations des reflets parmi lesquels on danse narcissiquement. Dans une société où tout est verbe d’action, c’est certes une évidente émancipation, une désaliénation au sens propre que de se faire sujet. Mais c’est aussi une soumission, dans l’attente d’être personne.
Un univers déterministe est moins fait d’acteurs que d’états transitoires, et on a vécu dans l’histoire des connaissances suffisamment de révolutions coperniciennes pour pouvoir dire, du bas de notre destitution : le moi, c’est un état. Notre plus grande liberté ne réside alors pas dans notre capacité propre à décider de cet état, mais en ce que nous choisissons d’en montrer. En toute conscience du fait que donner à voir c’est donner à exister, que comme dans la chimie subtile de la photographie, ce que l’on expose est ce que l’on développe.
La culture de l’individu et la culture de la masse, autant que la culture populiste qui parle à longueur de journée du « peuple » et des « gens », se tiennent coalisées en système dans l’ÉPIDÉMOCRATIE qui nous refuse la personne humaine. La personne, c’est-à-dire la petite cheville invisible qui tient ensemble l’être privé et l’être politique : aussi bien le « titre personnel » que la « persona » (c’est-à-dire le masque sur le théâtre monde) que « personne du tout ». Comme dans le récit de Kafka « L’Excursion dans la montagne », eine Gesellschaft von lauter Niemand – une société de personnes du tout. Comme Ulysse dont la survie dépend du fait d’être bien plus – ou bien moins – qu’anonyme-Anonymous, bien plus – ou bien moins – que caché : d’être Outis, Personne, qui est aussi le rusé (Mètis) et celui qui va vivre, qui a un nom alors même qu’il n’a pas d’identité. Être personne : à la fois la plus élémentaire dignité juridique et psychologique humaine, et littéralement l’identification au rien du tout, au rien qui constitue le tout. Pas flexible : fluide. Constante tension et contradiction : être-pour-autrui, c’est-à-dire pour personne, donc être-pour-soi – mais soi ce n’est personne, donc être-pour-autrui. La désirable négation de l’individu est aussi bien la négation de la frontière artificielle entre profondeur et superficie que la négation de la négation de la « vie privée » : celle par laquelle on se prive, par laquelle on se retranche, par laquelle on est personne pour pouvoir dans la vie publique être quelqu’un. Kénose, soustraction de soi qui ouvre une fenêtre sur le monde dans lequel on se retrouve, comme la « décalcomanie » de Magritte. Liberté d’apparaître et de disparaître, donc liberté d’ex-ister, non dans l’affirmation d’une individualité ou d’une invisibilité, mais dans la construction d’une collectivité qui n’appauvrit pas les possibilités de subjectivations, mais les multiplie et se trouve nourrie par elles. Entre sujets il y a un partage, plus ou moins équitable. Entre personnes, il y a une mise en commun, qui est un jeu – non de concurrence mais de coopération. Non un spectacle à dérouler (reprise ou streaming) mais une répétition ouverte.
Dans ce mouvement je dois/doit dire je. Si je réclame d’être un sujet politique, c’est afin de pouvoir être aussi tout autre chose. De pouvoir être multiple, être néant, être indéfinissable. Être, au plein sens du terme, « personne ». La condition en est d’abord qu’il existe une sphère de l’existence dans laquelle je sois sujet, et qui est le politique. L’ÉPIDÉMOCRATIE refuse ce droit en niant à la fois le privé et le commun dans le tourbillon de la sphère de circulation de la marchandise, en clamant qu’il n’y a que moi, l’individu, tout ensemble citoyen-travailleur-consommateur, bardé d’assignations variées qui sont identités fixes et non individuations processuelles, objet continu de sondages et d’enquêtes, point de données pour les statisticiens du big data, les algorithmes d’analyse d’audience des réseaux sociaux, et les épidémiologistes : en somme, sujet·te non-subjectivé·e de l’ÉPIDÉMOCRATIE. À socialiser et désocialiser, de préférence au travail.
Le droit à la personne est le droit à la sphère publique et à la sphère privée, articulées dans un projet démocratique démarchandisé qui est à réinventer – dans un monde qui pour être commun n’en est pas pour autant homogène, binaire, monolingue et unilatéral. Afin qu’ensemble nous déterminions, non une fois pour toutes mais indéfiniment et infiniment, des manières d’être au monde collectives, dans un calcul et une traduction définitivement inachevés et inachevables. Alors, dans nos dialectes, nous aurons la liberté d’être pure substance pensante traversée et bouleversée par nos émotions.