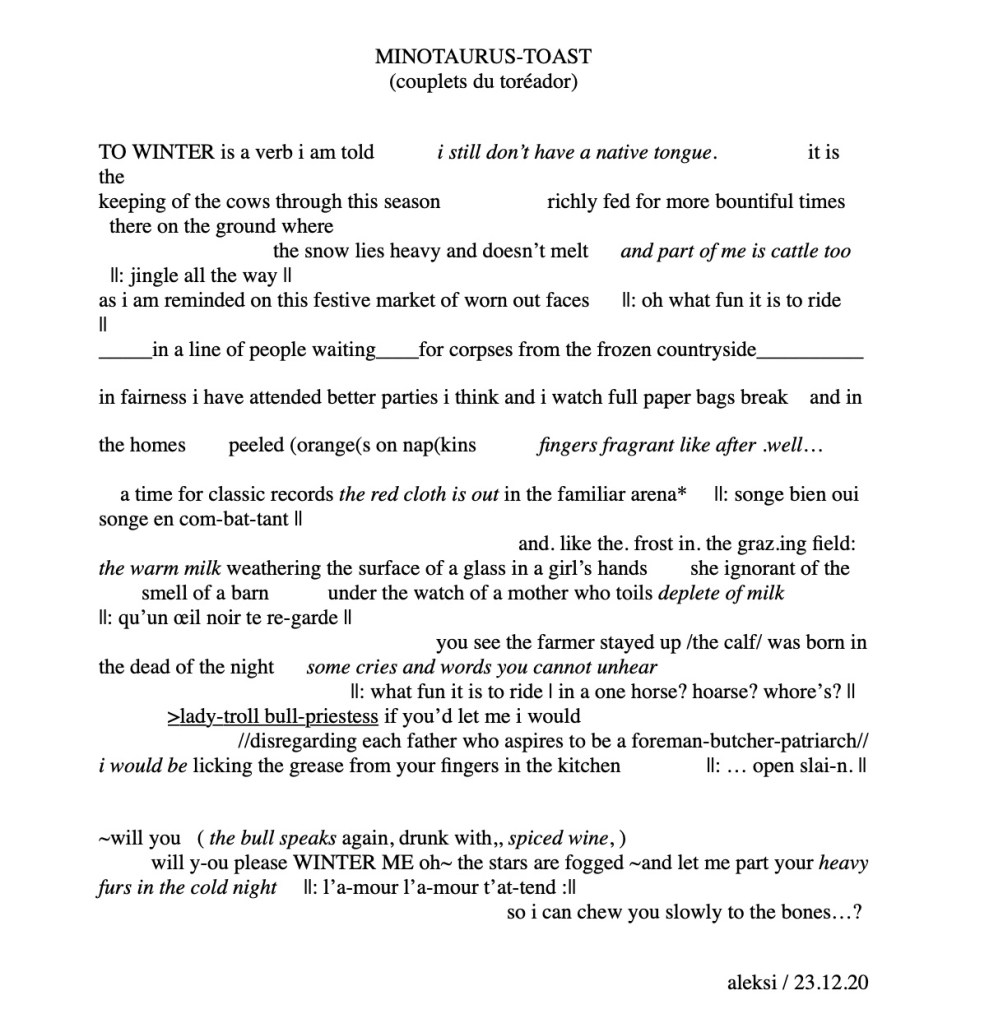À l’occasion de la pétition suggérant la panthéonisation des deux poètes.
« Terrible cortège » (pour citer le premier d’entre eux) que celui de ces ministres de la Culture qui s’en viennent pétitionner pour la mise en Panthéon de deux poètes qui n’ont rien demandé.
On se rappelle que le fils d’Albert Camus avait eu le bon sens de refuser que ce contre-sens soit infligé à la dépouille de son père. Car il y a des âmes qui ont mis toute leur énergie (œuvre et vie enfin mêlées) à sortir de tout plutôt qu’à entrer dans quoi que ce soit. À être irrécupérables à force d’être inacceptables même à leurs amis de vie ou de pensée, impardonnables même. « Ne vous laissez jamais mettre au cercueil », disait l’une d’entre elles, Antonin Artaud.
C’est en face du Panthéon, à l’Hôtel des Étrangers, au coin de la rue Racine et de la rue de l’École-de-Médecine, que se réunissaient les Zutistes, dont Verlaine et Rimbaud, dans une éphémère confrérie qui vomissait spirituellement tout ce qui au monde était officiel, jusque dans la poésie, surtout dans la poésie. Ce sont deux Quartiers Latins qui s’opposent là, entre lesquels il n’y a pas de synthèse possible, pas de réconciliation, mais seulement l’absorption de l’un par l’autre, la même récupération qui, pour la forme enguirlandée de Littérature, fait de tous les révolutionnaires des « gloires nationales », prétextes à l’auto-congratulation, et aussi bien de tous les quartiers populaires des investissements immobiliers pittoresques. C’est à tout cela qu’ils disaient Zut.
Qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas une question partisane. Ce n’est pas que la couleur politique de Rimbaud et de Verlaine les rende incompatibles avec le geste que consentirait tel gouvernement de telle autre couleur politique. C’est que Rimbaud et Verlaine n’ont rien à voir avec les gouvernements, avec le gouvernement en général. Ce n’est pas seulement qu’ils ne soient pas de ces figures édifiantes qu’il conviendrait de mettre dans cette conserve de « grands hommes ». C’est que, plus radicalement, ils n’ont même pas de programme. « Parce que c’est notre projet » ? Non, pas de projets, le présent seulement, la table rase : « Cette société elle-même. On y passera les haches, les pioches, les rouleaux niveleurs. » Faut-il les porter aux nues pour cette posture ? Non, justement pas. Ce ne sont pas des saints, pas des héros, pas des modèles. On ne souhaite à personne le brasier atroce d’être Verlaine ou Rimbaud. Même à un anarchiste ils n’offrent aucun catéchisme. Même à un hédoniste ils n’offrent pas de maître à vénérer ou de programme à suivre, pas en tout cas si on les lit vraiment, si on accepte de subir dans leurs mots le chemin tortueux de leurs violences et de leurs contradictions. Alors un roman national !
Rien de plus étranger à Verlaine et Rimbaud que la Nation. Rimbaud abhorre la France et le « patrouillotisme », pendant la guerre franco-prussienne il réclame l’occupation des Ardennes en même temps qu’il conchie Bismarck. De ses « ancêtres gaulois », il ne revendique que « la cervelle étroite » et « tous les vices » accumulés, il injurie la bêtise des paysans autant que celle des bourgeois. Rien à récupérer, pas un fond de gamelle à racler pour la Nation, pas même un paganisme bon ton pour accommoder un patriote en mal de racines ou de campagnes.
Rien de plus étranger à Verlaine et Rimbaud que l’État. Le mouvement, oui. Ce qui monte plutôt que ce qui pèse et impose. La Commune contre Thiers. Encore une fois, la sensation plutôt que le programme. Rien à construire, pas même un messie à attendre, mais le présent : « Il ne s’en ira pas, il ne redescendra pas d’un ciel, il n’accomplira pas la rédemption des colères de femmes et des gaîtés des hommes et de tout ce pêché : car c’est fait, lui étant, et étant aimé. »
Rien de plus étranger à Verlaine et Rimbaud, enfin, que la Culture. Les grands noms, les coteries, les établissements, les manuels scolaires. Cette Culture qui fabrique des grands hommes et les arrange en panthéons. Non, seulement l’art, geste par geste. Et même là, une bonne blague plutôt qu’un grand-œuvre. Et que s’étouffe dans sa bave l’esprit de sérieux. Rien qui dure, rien qui édifie. Rien à apprendre, tout à vivre dans leurs errements et leurs erreurs. Pas même un exemple à imiter par d’autres poètes, il n’en restera que des poses bohèmes affectées et de la mauvaise poésie grandiloquente.
Alors cette colonne de ministres, de la Culture de surcroît, devant la colonnade du Panthéon ! « On rit de tant de sottise solennelle », lance Verlaine dans son texte « Panthéonades », hommage ironique à l’intronisation de Victor Hugo « dans cette cave où il n’y a pas de vin ».
Passons sur l’injure dernière, l’argument de la pétition qui consiste, en gros, à faire du couple Verlaine/Rimbaud une carte « minorités sexuelles » à jouer – il est simplement abject et dans la droite ligne de toute la récupération de la culture et de l’histoire LGBTQ dont nous gratifient aujourd’hui les instances officielles et les entreprises avides de communication éclairée et de « pinkwashing ». Le travail de mémoire, oui, la lutte contre les discriminations à travers les représentations, mille fois oui, mais l’aseptisation des cultures alternatives, leur réduction à un folklore patrimonial, à une caution d’ouverture qui ne sert qu’à faire durer ce contre quoi les cadavres ainsi enrôlés s’étaient dressés, non, jamais.
Un autre Communard, Eugène Varlin, a fameusement écrit la phrase terrible : « Tant qu’un homme pourra mourir de faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines ». Tant qu’il y aura encore des palais où tout regorge, on n’édifiera pas à leurs portes des statues d’Eugène Varlin. C’est bien normal, il faut être conséquent. Alors que les ministres, tant qu’ils existent, ne se mêlent pas de mettre Rimbaud et Verlaine dans leur Panthéon. Personne n’est légitime à se revendiquer des jaillissements géniaux et monstrueux des esprits absolument libres et tourmentés qui se sont donnés sans concession à la jouissance, à l’idéal et à la destruction, tout ensemble et (surtout) dans le désordre.